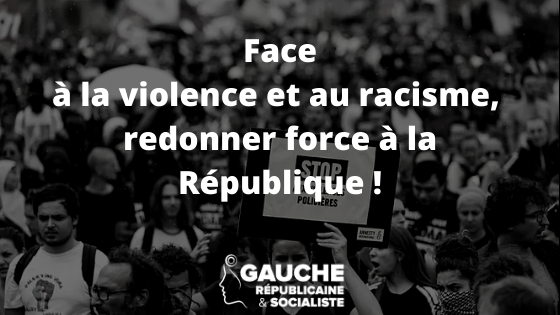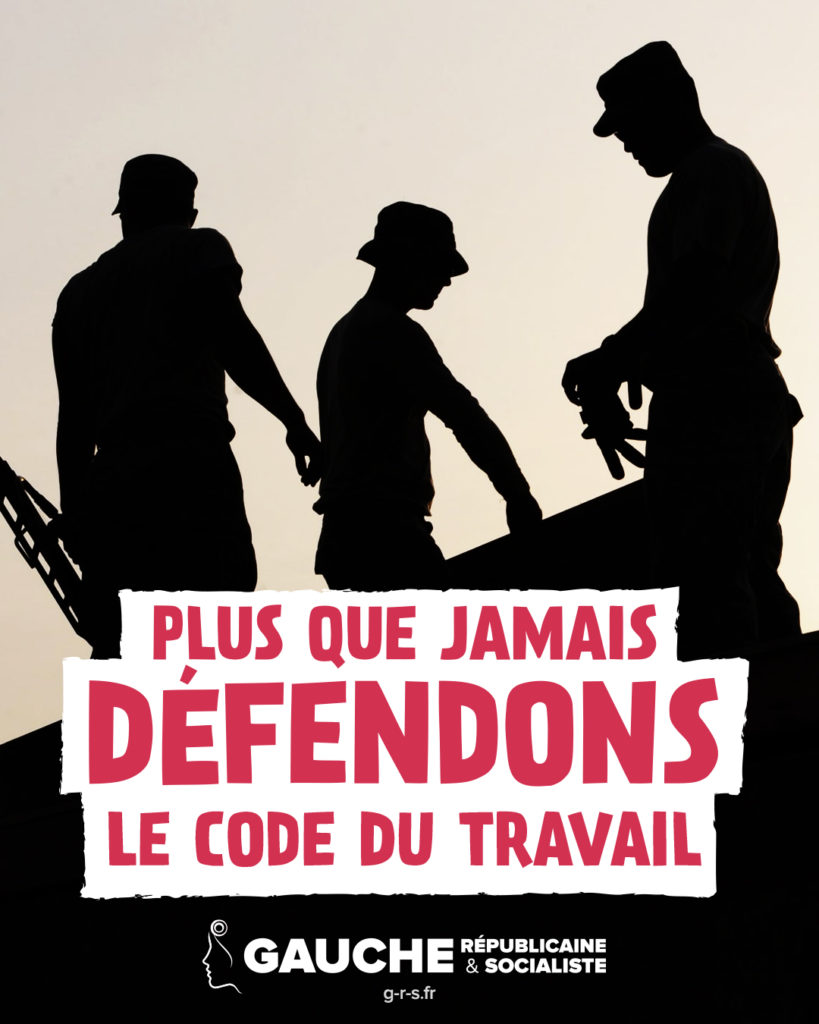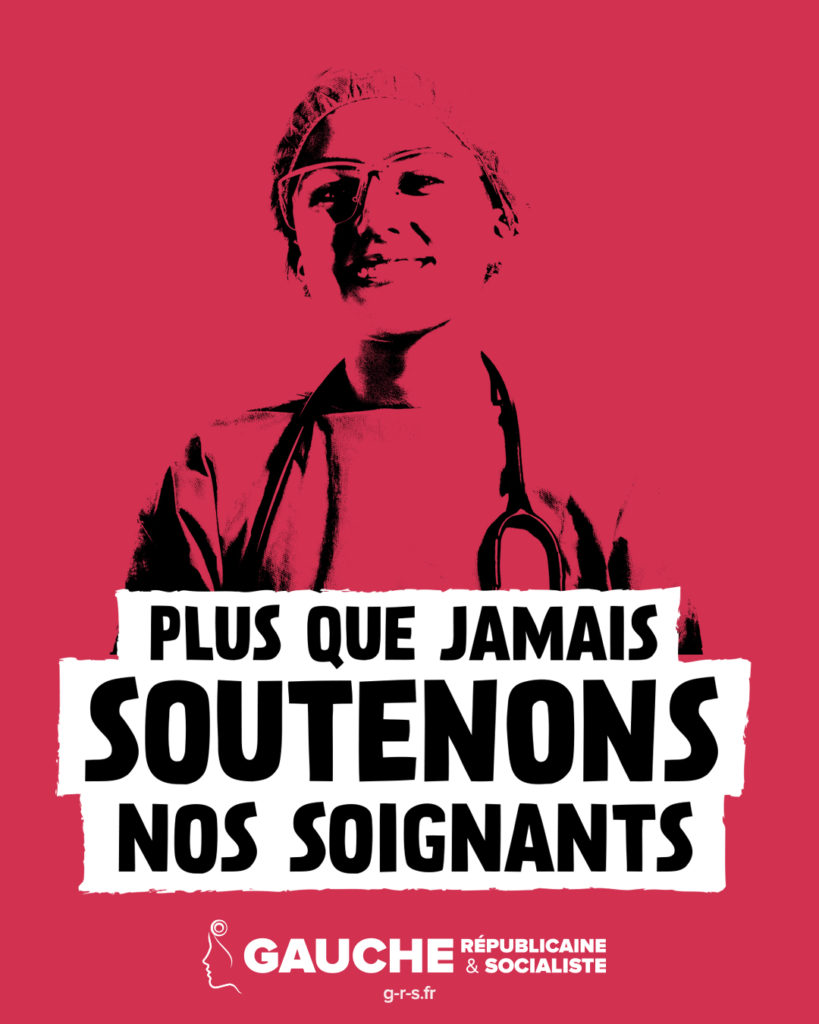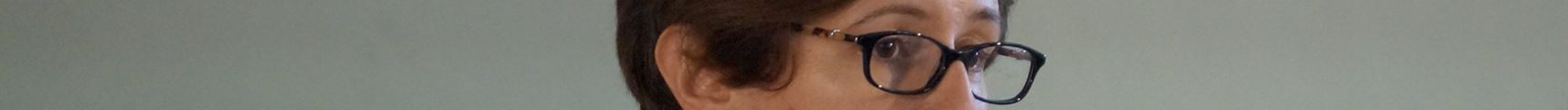Je publie ci-dessous le texte élaboré par la Gauche Républicaine & Socialiste face à la saine prise de conscience globale sur les violences policières et les actes racistes. Je veux cependant apporter mon analyse en introduction à ce texte, intéressant car il permet d'élargir la réflexion au-delà des seuls cas américains et français, pour montrer l'universalité des questions qui sont posées à nous et mettre ainsi à mal les aveuglements volontaires de certains de nos responsables.
Ainsi la mobilisation consécutive à l’assassinat de George Floyd à Minneapolis est nécessaire et salutaire. Elle couvre aujourd’hui toutes les démocraties occidentales et européennes et c’est heureux. Rien ne serait pire cependant qu’elle soit conduite par certains (volontairement) dans une impasse, où l’on n’entendrait plus que le dialogue de sourds entre certains syndicats de policiers – qui ne voudraient jamais remettre en cause des pratiques dévoyées au prétexte qu’attaquer les pommes pourries dans l’institution reviendrait à abattre l’institution elle-même – et certains groupuscules différentialistes – qui profitent de la défaillance de l’institution à reconnaître ses torts et à changer ses pratiques pour imposer dans une partie du public une idéologie raciste issue des dérives mal digérées une minorité de la gauche radicale américaine et mette en cause la République...
La République seule est la réponse : les principes édictés en France dès 1794 (abolition de l'esclavage attachée à la construction même de la République) et 1848 (nouvelle abolition de l'esclavage et définition de celui-ci pour la première fois en Europe et en Amérique comme étant un crime contre l'Humanité) en sont la preuve. Le fait qu’ils aient été trahis à de multiples reprises (soit parce que la République avait été mise à bas, par le consulat de Bonaparte en 1798, par le coup d'Etat de son neveu en 1851 pour établir le Second Empire ; soit parce que les gouvernements républicains eux-mêmes se fourvoyaient, avec la colonisation et les guerres de décolonisation notamment) ne les rendent pas moins pertinents. Les gouvernements et les Hommes politiques sont faillibles, c’est donc de la responsabilité des forces républicaines – a fortiori à gauche – d’assurer la mobilisation permanente pour garantir que les actes de l’institution soient fidèles aux principes républicains. Il est de notre responsabilité de tout faire pour que la Liberté, l’Égalité et la Fraternité soient des réalités concrètes et vécues par chacun de nos concitoyens : la tâche est immense car dans tous les domaines – économiques, sociaux, lutte contre les discriminations, accès à la culture et à l’éducation, égalité femmes-hommes – nous sommes loin du compte ! Des décennies de dérives libérales ont conduit à des dégâts immenses dans la vie quotidienne de nos concitoyens, ont aggravé tous les processus de rupture d’égalité, ont donné du grain à moudre à tous ceux qui haïssent la République (qui est la seule manière dont je conçois la France)...
Sur la question des seules violences policières, après avoir contribué fortement à leur aggravation, l’actuel gouvernement semble avoir pris conscience de la déchirure voire du gouffre qui s’ouvrait devant tous les représentants de la puissance publique ; mais il est resté au milieu du gué (sans doute terrifié de devoir affronter quelques intérêts pour consolider et rénover l’institution policière, car les représentants de ces intérêts sont souvent le dernier rempart physique de ce gouvernement dont l’assise politique a toujours été faible et se réduit chaque jour) et devra proposer plus que quelques belles paroles.
Ainsi, si l'expression de racisme d'Etat est donc impropre en France, le débat sur la définition de "racisme structurel" peut être entendu mais doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Le Défenseur des Droits vient de pointer une politique systématique dans un arrondissement de Paris d'arrestations de personnes de couleur ; il considère ici qu'il ne s'agit plus de l'acte d'un individu mais d'une structure, il a également pointé le fait que ses interpellations sur les dysfonctionnements de l'institution n'avaient pas reçu de réponses depuis 5 ans. Soyons clairs, il existe en France une politique ou une stratégie particulière qui a des effets de « racisme institutionnel », c'est celle qui préside aux contrôles d'identité. C'est un cas particulièrement choquant : toutes les études montrent que lorsque vous êtes jeunes, noirs ou d'origine maghrébine, vous avez 10 à 20 fois plus de « chances » d'être contrôlés : cela signifie que 3 ou 4 fois par jour au bas mot une personne de ces catégories peut-être contrôlée, ce qui explique aisément un sentiment de ras-le-bol, de révolte et parfois les propos et les actes qui vont avec (avec les conséquences que l'on peut imaginer). Dans un article, Patrick Weil avait comparé cette situation au code de l'indigénat, qui impliquait des peines spéciales décidées par l'administration coloniale pour les Algériens, qui bien que Français ne bénéficiaient pas pleinement de la citoyenneté du temps de l'Algérie coloniale. Cette pratique s'apparente donc à une peine administrative appliquée à une catégorie de la population qui doit justifier plus que d'autres de son appartenance à la Nation, du fait de son apparence … et cela devant ses amis, devant ses proches, devant les collègues de travail qui eux ne seront pas contrôlés, et le fait que cela se passe également parfois sans témoin n'en diminue pas l'ineptie. Les justifications prétextées pour cette pratique discriminante sont de deux ordres : l'immigration irrégulière et le trafic de stupéfiant... Notre police est affectée pour une trop grande part au contrôle et à la répression du commerce et de la consommation d'une drogue qui est aujourd'hui légale au Canada et dans de nombreux Etats européens et des USA : la marijuana. Ces policiers doivent être affectés à des tâches autrement plus importantes pour l'ordre public, notre sécurité et la concorde civile. Avec cette réforme, l'essentiel des contrôles d'identité et leur justification tendancieuse disparaîtrait. Les fonctionnaires de polices et de gendarmerie ont par ailleurs des moyens matériels et logistiques qui leur manquent cruellement pour faire leur métier correctement ; ils ont besoin d'effectifs suffisants et d'une autre répartition de ceux-ci (car si une certaine gauche dénonce la création de plusieurs milliers de postes de policiers ces derniers elle fait fausse route, le problème n'est pas leur création mais là où ils sont affectés, et pour quelles missions).
La crainte d'une partie du public à l'égard de la police s'est également accrue avec la modification des méthodes de maintien de l'ordre depuis plusieurs années, alors qu'auparavant elle était considérée comme un modèle en Europe et aux Etats-Unis. Les nassages, les grenades explosives, les LBD, la stratégie de pression sur les manifestants conduisent aux débordements qu'ils sont censés éviter. Ce problème ici ne vient pas directement des policiers, mais de la stratégie qu'on leur demande d'appliquer. Les hommes comptent dans ces matières : M. Papon était dans les années 1960 Préfet de police de Paris ; sous son autorité ont eu lieu le Massacre de Charonne et celui des manifestants pro-FLN du 17 octobre 1961. Le Préfet Grimaud qui lui a succédé avait une toute autre politique en matière de maintien de l'ordre, il est évident que de nombreux manifestants de Mai-68 doivent la vie à ce changement de préfet. À un moment, il y a la responsabilité des chefs qui donnent des consignes et des stratégies, et les policiers ne sont souvent que des agents qui doivent obéir aux ordres qui leur ont été donnés (tant qu'ils ne sont pas illégaux). Un gouvernement couvre-t-il la violence policière ? Celle-ci doit se gérer par le Juge ; il est donc sans doute souhaitable que l'inspection de ces services ne soit plus dépendante de l'institution policière elle-même, mais d'une administration indépendante comme le Défenseur des Droits. L'indépendance de l'évaluation policière est un sujet sérieux, d'autant plus qu'il faut également protéger les policiers, qui ont un métier extrêmement difficile, que peu de gens ont envie de faire, qui nécessite tout à la fois maîtrise de soi, connaissance de la loi et possibilité d'user de la violence légitime pour protéger la société... Cette évaluation n'en est pas moins nécessaire mais il faut faire confiance aux institutions judiciaires pour résoudre les actes individuels. Il y a quelques jours le media StreetPress révèle voici quelques jours l'existence d'un groupe facebook privé de quelques 8 000 policiers ou gendarmes radicalement raciste, c'est absolument énorme ; mais pourquoi faut-il que ce soit un organe de presse qui révèle cela ? Les services de renseignements et d'information du ministère de l'intérieur ne les avaient donc pas repérés ? Ils lutteraient contre le radicalisme de tout ordre, mais où sont-ils pour démanteler des groupes radicaux comme celui-là ?
C’est donc à une véritable révolution citoyenne que nous devons soumettre à long terme nos politiques publiques. C’est aussi un effort constant tant culturel que politique que nous devrons conduire pour garantir que l’extrême droite soit combattue dans la police et la gendarmerie, pour que nous puissions compter sans faille sur nos Gardiens de la Paix, pour que les communautaristes et les différentialistes ne puissent plus jamais se planquer derrière une quelconque proximité avec une partie de la gauche et soient politiquement combattus comme les racistes de droite et d’extrême-droite dont ils partagent finalement la vision de la société.
Frédéric FARAVEL
Le meurtre de Georges Floyd par quatre policiers de Minneapolis (Minnesota) est la dernière goutte de sang faisant rompre des digues dans les opinions publiques occidentales.
La prise de conscience en cours dépasse le cadre américain et rappelle dans l’universalité de la réponse des jeunesses des sociétés riches les mouvements oubliés contre l’apartheid de l’Afrique du Sud des années 1980.
Ainsi, malgré la conscience du risque pris, alors que la pandémie due au Covid-19 n’est pas finie, des dizaines de milliers de manifestants, jeunes pour la plupart, masqués, ont manifesté partout en Europe contre le racisme et les violences policières : Bruxelles, Londres, Copenhague, Berlin, Munich, Francfort, Hambourg, et même, malgré l’interdiction prononcée par les préfets, à Paris et plusieurs grandes villes de France. À Bristol, une statue de l’esclavagiste Colson a été jeté dans le port.
Tous les cortèges ont en commun de rassembler des jeunes, entre 18 et 35 ans, beaucoup de primo-manifestants, tous habillés de noirs. C’est un mouvement d’opinion qui rebondit sur celui des “Friday” pour le climat. Il démontre un refus de thèses et d’organisations sociales et politiques au cœur du néolibéralisme, et dont le protecteur dévoyé est souvent la police.
Il ne constitue pas encore une alternative, et les contradictions sont nombreuses encore entre tenants de l’universalisme humaniste, et ceux, adhérant paradoxalement à la définition néolibérale d’une humanité divisée en identités et inégalités de nature, privilégiant l’individualisme de la communauté, et niant les solidarités de classe. C’est le piège de ce moment : il y a des libéraux souhaitant le repli individualiste ou communautaire pour nier les classes et les questions sociales ; il y a des faux universalistes souhaitant plonger la tête dans le sable, privilégiant la conservation de l’ordre social à la résolution de sa violence. Les uns ne veulent pas de la République, les autres nient qu’elle soit sociale.
L’Allemagne face aux infiltrations terroristes de sa police
À Berlin, à Munich, à Hambourg, à Nuremberg, dans de nombreuses villes allemandes, les manifestations ont fait le lien entre racisme et violences policières.
Dans ce pays, les policiers doivent prêter serment à la loi fondamentale, qui inclut la déclaration des Droits de l’Homme, et proclame le caractère intangible de la dignité humaine.
À ce titre, il est jugé incompatible avec le service public l’engagement dans des partis et mouvements d’extrême droite tels que le NPD.
Il y a presque dix ans, on découvrait cependant que dix meurtres, neuf immigrés d’origine turcs ou grecs, et une policière, avaient été commis par une cellule terroriste d’extrême droite, la NSU. Tout au long des enquêtes, la police n’avait pourtant jamais prospecté sur cette piste, privilégiant des « règlements de compte entre maffias et clans », se plaignant d’une omerta empêchant le recueil d’informations sur cette maffia, qui n’existait pourtant que dans les préjugés racistes des enquêteurs.
Depuis, les groupements d’extrême droite ont renforcé leurs efforts pour infiltrer la police.
Depuis quelques années, les autorités ne réagissent plus par des enquêtes administratives, comme la France continue elle à le faire avec l’IGPN, juge et partie, mais directement en saisissant les services secrets intérieurs.
C’est ainsi qu’en 2018 un groupe Whatsapp de 40 policiers a été identifié et observé : ces policiers, du Land de Hesse, utilisaient les bases de données de la police pour envoyer des lettres de menaces à des militants antiracistes et des avocats des victimes de la NSU. Suite à une perquisition en février 2020, il a été prouvé que certains de ces fonctionnaires avaient détourné armes et munitions des dépôts policiers en vue de préparer des actions terroristes. Les enquêtes en cours ont entraîné les limogeages immédiats des fonctionnaires concernés.
La co-présidente d’un des partis au gouvernement, le SPD, Saskia Esken, a réclamé hier une grande enquête sur le racisme dans la police. Elle n’est pas seule : les autorités hiérarchiques policières elles-mêmes parlent de combattre le racisme dans leur rang, de renforcer formation et encadrement, de se donner les moyens pour maintenir une police républicaine, loyale au serment à la loi fondamentale.
Samedi, malgré des affrontements en fin de manifestation à Berlin et 93 arrestations, le chef de la police a « remercié » les manifestants « majoritairement pacifiques » et loué leurs efforts pour respecter la distanciation physique – discours si différent d’un Castaner déclarant en janvier 2019 « ceux qui viendront manifester savent qu’ils seront complices des débordements » ou d’un préfet de police indiquant à une manifestante âgée qu’ils n’étaient « pas dans le même camp ».
Une culture de l’impunité est la négation de la République
Ce long développement permet de souligner la culture de l’impunité qui s’est établie en France. Aujourd’hui même, le rapport du Défenseur des Droits la dénonce : en cinq ans, le Défenseur des droits a demandé des poursuites disciplinaires dans trente-six affaires de manquements aux règles de déontologie, sans recevoir de réponse.
La République proclame l’égalité de toutes et tous devant la loi. Cela vaut également pour ceux dépositaires, au nom du peuple souverain, du monopole de l’exercice de la violence légitime. Le peuple républicain attend de sa police protection et service, pour pouvoir jouir des libertés publiques garanties par la constitution.
Cependant, l’exercice de la violence ne reste légitime que s’il est contrôlé, encadré, si les Gardiens de la Paix sont formés et dirigés correctement, si des effectifs et des moyens nécessaires et suffisants permettent d’assurer les missions.
Devenir policier est un engagement au service de la Nation qui peut rendre nécessaire le sacrifice de sa vie pour sauver les autres. C’est un métier difficile, ingrat, à la conjonction de demandes contradictoires, entre des politiques néo-libérales qui veulent gérer à coup de matraque les inégalités sociales, une Nation espérant Protection et Soutien, et des groupes sociaux et politiques s’affranchissant de la République.
Il faut le dire : le gardien de la paix est au cœur du pacte social républicain, comme le professeur, l’infirmière, le militaire, le pompier. C’est pourquoi les attentes sont également particulièrement élevées quant à l’exemplarité de son comportement en fonction. Tout cela implique de garantir l’exemplarité par la sanction immédiate des comportements déviants.
En France cependant, de faux républicains affirment l’infaillibilité de nature de la police.
Républicaine par la force des textes de lois, elle serait sans faute ni tâche. Elle devrait dès lors être soustraite à tout examen de son action, ses fonctionnaires considérés au-dessus de tout soupçon.
Cette culture de l’impunité est entretenue par le rôle prééminent donné à l’IGPN, autorité de contrôle administrative interne.
L’absence de contrôle s’accompagne de la lâcheté hiérarchique. Comment un groupe Facebook a-t-il pu atteindre 8 000 membres sans qu’un seul gradé, face aux centaines de messages racistes et sexistes, n’intervienne ? Comment se peut-il qu’un tel groupe ne soit pas surveillé par la sécurité intérieure ?
Cela s’explique par une raison simple : depuis 2005 au moins, la police est utilisée comme instrument principal de lutte contre les révoltes et les colères sociales, tout en restant une variable d’ajustement budgétaire, dont on réduit toujours les effectifs ou les moyens concrets, poussant ses fonctionnaires à bout, jusqu’aux « épidémies de suicides ».
La hiérarchie policière, versée dans la seule répression sociale, au point d’agresser les journalistes et les parlementaires en manifestation, sous estime le danger d’infiltration des institutions par des groupes et idéologie d’extrême droite souhaitant la guerre civile européenne.
Ces idéologies sont à l’origine des attentats d’Anders Breivik en Norvége en 2011, du tueur de Munich en 2016, du meurtre de la députée travailliste britannique Jo Cox en 2016, des attentats en Allemagne contre des élus, des juifs et des turcs en 2019 et 2020.
Pourquoi une police où les syndicats affiliés à l’extrême droite ont fortement progressé ces dix dernières années serait-elle immunisée face à un phénomène européen ?
L’égalité devant la loi nécessite de remettre les deux moteurs inséparables, la sanction et la formation, au cœur de la réforme de la police républicaine.
Il est insupportable que des personnes, interpellées pour des délits, meurent au moment de leur interpellation, qu’ils s’appellent Traoré ou Chouviat. La doctrine et les techniques d’interpellation doivent changer, l’obligation de secours à la vie redevenir prioritaire à l’accomplissement d’un acte administratif visant à sanctionner un outrage.
Il est contraire à la République que la police ne garantisse plus l’exercice des droits fondamentaux, tel que celui de manifester, de s’exprimer, mais au contraire les en empêche. Ce n’est pas le rôle de la police de décrocher, pendant le confinement, des banderoles d’opposants accrochés à des balcons privés. Il est absolument intolérable que des élus, des journalistes, des syndicalistes, soient des cibles dans les cortèges. Personne ne devrait perdre un œil ou une main dans l’exercice d’un droit fondamental. Il est absolument nécessaire de pourchasser devant la justice tous les actes de violence non proportionnés de membres des forces de l’ordre. Il n’est pas proportionné aux impératifs de maintien de l’ordre d’éborgner, amputer, et blesser des citoyens libres de manifester.
* * *
Aux États-Unis, le Parti Démocrate a annoncé une grande réforme de la police en cas d’alternance. En Allemagne, le plaquage ventral est maintenant interdit. La France, en retard, sous la pression internationale, a annoncé l’interdiction de la prise d’étranglement mais reste dans l’ambiguïté sur le plaquage ventral.
La confiance dans la République et sa police exige à la fois de la réformer, de mieux la former et l’encadrer, et de briser la lâche impunité que lui garantit le pouvoir actuel.
Remettre de la République dans la police, c’est remettre de la République dans la société, et par conséquent, s’attaquer aux conséquences sociales de 40 ans de destruction néolibérale de l’Etat et de la cohésion nationale.